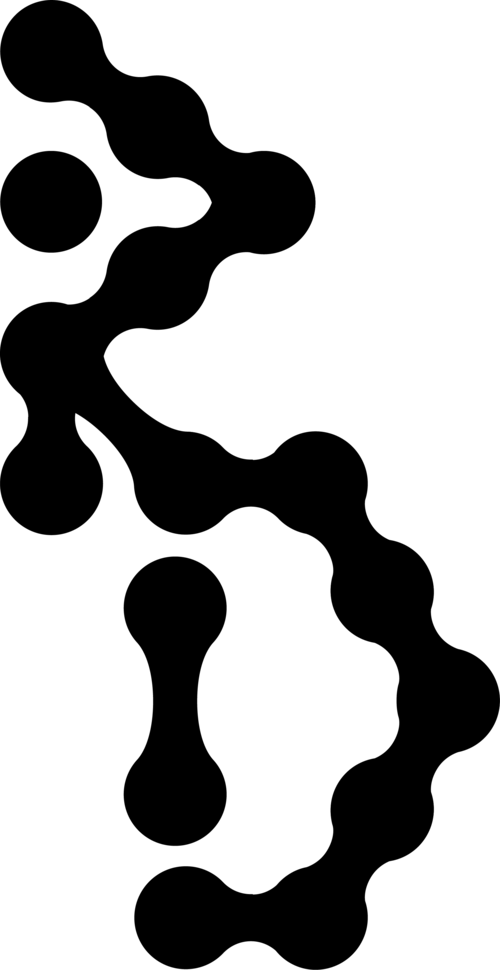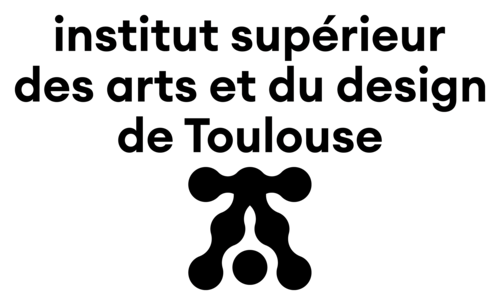Enquête sur les producteurs
Au mois de janvier 2018, un groupe d’étudiants de l'isdaT est parti à la rencontre de divers producteurs et éleveurs de la région pour parvenir à une meilleure compréhension du métier et de ses enjeux, ceci en vue de penser une signalétique (ou un traitement graphique) autour des produits.
Rencontre avec une vigneronne, Domaine de Cantalauze
Localité : Lintin CAHUZAC-SUR-VÈRE
Superficie : 8 hectares de vignes
Date d’installation : 1982 >2nd génération 2014
Type de culture : Vignobles - vente directe
Label : Nature & Progrès

Issus d’une école d’ingénieur, Pauline Laurent a une spécialité en marketing et communication et son mari en œnologie, ils reprennent l’exploitation de leurs parents pour être en adéquation avec leurs valeurs et faire perdurer le bio à une échelle locale.
L’obtention de la certification, ses rapports avec les organismes certificateurs
Le label Nature et Progrès repose sur un système participatif de contrôle intégrant les agriculteurs et les consommateurs. Il permet aux producteurs d’être plus autonome. Par ailleurs, ce label les responsabilisent puisqu’ils prennent part à un processus de contrôle évolutif :
ce qui est interdit, ce qui est autorisé et ce qui est encouragé est amené à changer en fonction du contexte et des circonstances. Avec ce label, le producteur est considéré comme un expert, c’est lui qui est à même de savoir ce qui est bon pour son champ.
Quelles méthodes de culture sont mises en place pour pallier au maladies des plantes et pour éviter les intrants chimiques ?
Pauline et son mari n’ajoutent aucun intrants chimiques. En fonction des conditions climatiques, des parasites, ils cherchent des solutions naturelles qui seront encadrées par le cahier des charges de Nature et Progrès.

Temps de culture, fréquence des rendements ?
Leur production est très saisonnière (la vigne ne produit qu’une fois par an à une période précise), en janvier c’est le temps de la taille des pieds, et fin janvier l’arrivée du vin nouveau.
Mode de distribution
Ils vendent leurs vins en circuit direct plus de 90% du temps et font quelques foires bio et salons de vins dans le secteur pour entretenir le réseau, “les meilleurs systèmes sont ceux basés sur les relations humaines”.
Rétribution financière
Grâce à la vente directe 100% des bénéfices leur revient.
Pour le Cantalauze par exemple à 4 €50 HT en bouteille, il y a 1€ de charges comprises pour la bouteille (bouchon + étiquette + capsule + verre) à quoi il faut aussi soustraire les frais liés au personnel des vendanges, à l’entretien des machines, des champs de vignes…
Après ces différents frais, il leur reste de quoi se verser un salaire.

La position du producteur vis à vis des labels
D’après Pauline, le fait que label AB ne soit basé que sur un produit pose problème. Le produit n’est pas examiné en relation avec le contexte environnemental de production, il s’agit uniquement d’un contrôle administratif mais on parle de transparence c’est un organisme extérieur qui procède à ce contrôle.
Pour la vigneronne, la notion de “vin nature” (label) : ne veut rien dire ! C’est une notion très relative, qu’est ce qui est naturel ou pas? Il faudrait une définition rationnelle et précise qui ne laisse pas place à interprétation, cela le principe du cahier des charges le garantie.
« Il y a milles façon d’être induit en erreur par les étiquettes des bouteilles de vins. On emploie des termes qui ne traduisent pas le mode de production derrière la bouteille.»
Comment pourrait-on communiquer autrement sur les produits ?
Aujourd’hui on peut tout avoir, comment avoir des repères ? On est obligé de cheminer, et tenter de trouver des balises, cela passe par l’étape de la recherche.
Il y a milles façon d’être induit en erreur par les étiquettes des bouteilles de vins. On emploie des termes qui ne traduisent pas le mode de production derrière la bouteille.
Dès lors comment faire gage de confiance sans label ? Pour elle le seul moyen de garantie tient dans le rapport direct que peuvent entretenir le client qui vient à la cave et échange avec le producteur. Mais il est essentiel pour elle d’avoir une garantie, ce qui implique le respect d’un cahier des charges.
Rencontre avec des producteurs de fromages de chèvre, EARL du Bila
Localité : Mauzac
Superficie : ± 15 hectares
Date d’installation : 2009
Type de culture : fabrication de fromages de chèvre
Label : pas de label
Patrice et Emilie ont crée l’atelier et acheté leurs premières chevrettes en 2009 pour entrer en production en 2010. Ils n’ont pas de label car aucun label n’est spécifique au fromage de chèvre sur le territoire. De plus, leur production n’est pas entièrement bio. Le troupeau est constitué de 52 chèvres. Pour des raisons techniques et sanitaires, les chèvres ne sortent pas de la grange. L’environnement autour de l’exploitation est constitué d’habitations, ce qui poserait un problème en cas de fuite, mais les chèvres sont également très sensibles aux parasites.
La quinzaine d’hectares est utilisée pour des cultures de foin de Luzerne, de foin de graminée, d’orge aplati et de maïs. Patrice et Emilie sont autonomes dans la production des fourrages pour nourrir leurs chèvres. Ils cultivent également une parcelle céréalière pour la vente.
Ils sont principalement deux à travailler sur l’exploitation, Patrice s’occupe plus particulièrement des cultures et de l’élevage et Emilie prend en charge la transformation fromagère ainsi que la vente. Une salariée intervient à mi-temps. Le laboratoire de fabrication des fromages est situé dans l’exploitation.

Quelles méthodes de culture sont mises en place pour pallier au maladies des plantes et pour éviter les intrants chimiques ?
Quelques traitement sont effectués sur les céréales si le printemps est humide, ou s’il la présence d’une maladie est détectée.
Patrice utilise le fumier de ses chèvres comme fertilisant pour le sol.

Temps de culture, fréquence des rendements ?
Les chèvres ont une période de reproduction qui va du 15 août au 15 novembre environ. Elles peuvent donc faire les chevreaux entre le 15 décembre et le 15 mars.
Elles entrent en production au moment où le chevreau naît. La production de lait dure de janvier à juin. Durant deux mois, les chèvres ne sont plus en production, elles sont taries pour permettre le bon développement du chevreau.
Matériel
Patrice utilise des outils communs, partagés avec d’autres agriculteurs. Ce moyen de coopération leur permet d’obtenir du matériel trop coûteux pour une utilisation personnelle.

Mode de distribution
Patrice et Emilie passent par différents modes de distribution; la vente en circuit court, la vente directe.
La vente en circuit court est effectuée par l’intermédiaire d’un marché, de La Ruche qui dit oui ! ainsi que de la vente chez certains fromagers du village.
Rétribution financière
Ils favorisaient à leur début la vente directe mais distribuent aujourd’hui davantage aux fromagers.
La position du producteur vis à vis des labels
Patrice cite l’exemple d’un agriculteur situé à Perpignan qui cultive des produits fortement réglementés par des cahiers des charges et parfois sans logo. Il produit selon des règles strictes qui lui sont imposées concernant les traitements alors que ses légumes sont par la suite mis en vente sans que ces informations n’apparaissent. Ses produits se retrouvent alors à côté de légumes venant d’Espagne par exemple, sans réelle distinction de production. Les consommateurs n’ont alors pas accès à certaines informations et ne peuvent pas décider d’un choix conscient.
« Il faudrait davantage communiquer sur les façons de produire dans une exploitation, car on ne s’imagine pas la quantité de travail.»
Comment pourrait-on communiquer autrement sur les produit ?
Selon Patrice, la meilleure manière de parler d’un produit est d’avant tout de le goûter.
De manière générale, il faudrait davantage communiquer sur les façons de produire dans une exploitation, car on ne s’imagine pas la quantité de travail.
Rencontre avec une maraîchère, Les jardins de Corinne

Localité : Longages (31)
Superficie : 1,5 hectares + 3000 m²
Date d’installation : Démarrage en 2011 > 2014
Type de culture : Maraîchage, fruits et légumes en pleine terre
Label : ECOCERT

Corinne travaille seule sur son exploitation, qui dénombre pas moins de 100 variétés à proposer à ses clients tout au long de l’année. Elle est prise tous les jours par l’entretien du terrain, la récolte, la livraison des produits.
L’obtention de la certification, ses rapports avec les organismes certificateurs :
Avant même d’être certifiée bio, l’exploitation de Corinne était déjà sans le moindre intrant chimique, car même faire de l’agriculture raisonnée c’est continuer de faire appel à du chimique. Elle respectait donc le cahier des charges d’Ecocert sans même y être, il ne lui restait plus qu’à régler la question de la labellisation des plans qu’elle achète ( 2 fois plus chers ) et du compost. Sous le label, elle s’expose à 3 - 4 contrôles surprise par an
Quelles méthodes de culture sont mises en place pour pallier au maladies des plantes et pour éviter les intrants chimiques ?
Les variétés sont choisies en fonction de la qualité de son sol, qui est régulièrement enrichi en compost afin d’éviter tout épuisement. Le mildiou est le principal parasite traité à la bouillie bordelaise sur les tomates en extérieur par exemple. L’avantage de la serre c’est qu’il n’y a pas de maladies. La diversité des légumineuses et le respect de la saisonnalité permet de parer à une production en dessous des prévisions, un parasite…

Temps de culture, fréquence des rendements ?
Il y a un roulement des récoltes sur toute la ferme. Une variété laisse place à une autre. Tout au long de l’année il y a donc une production, même si elle est moindre en hiver car ne concerne que quelques légumes d’hiver. N’ayant pas de temps à y consacrer, les plants sont achetés démarrés, prêt à mettre en terre.
Mode de distribution
Corinne vend en circuit court via “la ruche qui dit oui” ou via le marché hebdomadaire.
Le marché oblige le producteur à avoir une bonne estimation de la quantité de denrées qui pourront sortir de terre. Avec le panier précommandé, on ne récolte que ce qui est nécessaire.
Rétribution financière
Corinne verse 16% de son chiffre d’affaire à la plateforme “la ruche qui dit oui”, elle doit aussi déduire les frais de transport quotidien pour livrer ses produits, ainsi que 450 € / an qu’elle verse à l’organisme certificateur Ecocert.

La position du producteur vis à vis des labels
Les médias disent qu’ils faut manger du bio, dans la pensée collective si il n’y a pas de label, c’est que les produits ne sont pas bio. Le label le prouve, c’est un gage de confiance (cahier des charges). S’il existait un organisme gratuit qui faisait le même travail qu’Ecocert elle le prendrait. S’il n’y avait pas de label le producteur devrait se justifier quand à sa manière de de travailler. Décrire avec précision les méthodes de production sur les marchés peut s’avérer compliqué sur les marchés, par ailleurs la parole du producteur ne suffit plus à faire garantie.
Pour elle, il ne devrait pas forcément y avoir un label mais une qualité de travail qui soit mise en place par la chambre de l’agriculture, elle détient tous les dossiers des agriculteurs qui s’installent, il serait facile pour elle d’observer les intrants sur une exploitation. Il faudrait ne pas être obligé d’avoir à payer un label pour dire qu’une exploitation est “propre”.
Comment pourrait-on communiquer autrement sur les produits ?
Pour elle il faudrait différencier les produits autrement que par l’appellation “ bio / pas bio”, mais signifier qu’un produit a reçu des intrant où non. Elle pense par exemple à un système de pastille à appliquer (pastille verte : aucun produit, / pastille rouge : beaucoup traitements). Penser une autre manière de communiquer sur les produits permettrait peut-être d’éviter la valorisation systématique du bio qui pousse à aller chercher du bio à l’extérieur car il est moins cher qu’en France.
Rencontre avec un céréalier, Patrick Oger
Localité : LES HERMITES, 37110
Superficie : 32 hectares
Date d’installation : 2015
Type de culture : Cultures, ail, céréales, oléagineux
Label : AB, ECOCERT

Patrick Oger est un néo-paysan depuis maintenant 3 ans.
Il cultive des céréales, de légumineuses et des graines oléagineuses. Il produit de l’ail et le transforme en poudre, conserves, ail séché.
Temps de culture, fréquence des rendements ?
La période de production se fait en juin juillet. Les semis et semences commencent à l’automne. En hiver, la plantation de l’ail et sa production se font de novembre jusqu’à avril. Le travail en tant que tel ne s’arrête jamais.

Mode de distribution
Pour commercialiser sa future farine Patrick Oger vise la grande distribution bio et pas bio car il y a une forte demande dans la restauration à domicile, ainsi que les artisans boulanger. Il fournit de manière régulière, de grandes quantités, vente en collectif, en commun. (ex: le collectif «Greniers collectifs»). Il voudrait passer du global au local et arrêter de faire de l’international et s’investir dans la vie locale pour s’ancrer quelque part car il s’agit d’une exploitation et d’une terre familiales.
Rétribution financière
Il fournir de manière régulière en grandes quantités pour pouvoir se grouper et vendre en collectif.
La position du producteur vis à vis des labels
Le label AB est le seul label qui a une démarche volontaire où on va payer pour être contrôlé. C’est un label qui n’est pas mis au point par les producteurs mais par le public et ses représentants. Ce ne sont pas eux en tant que producteurs qui maîtrisent le cahier des charges, c’est la société qui leur demande de remplir un cahier des charges, et ils le remplissent volontairement. Beaucoup de labels de producteurs (locaux, labels rouges...) se sont mis ensemble pour dire qu’ils font tel produit, de tel manière, sur tel terroir; mais qui a mis au point ce label ? Ce sont les producteurs eux mêmes, “c’est un peu de l’entre soi” (pas bipartite ou tripartite). Le label AB justement est tripartite ; il s’agit de la demande de la société et des politiques qui imposent un cahier des charges aux producteurs. Il y a une grande différence entre les deux.
Nature et progrès va encore plus loin. Les producteurs et les consommateurs se réunissent et discutent de leur desiderata. Ils font les contrôles ensemble, ils vérifient non seulement la qualité technique, biologique, mais aussi la qualité sociale, environnementale. C’est un ensemble cohérent et global de la production et de la consommation. Tous les labels ne sont pas comparables.
Pourquoi s’associer à ce label, pourquoi ne pas faire cette démarche soi même (agriculture bio) ?
Faire tout ce qu’on ferait sous le label AB sans payer et être certifié ?
Parce qu’ils n’ont pas le lien direct au consommateur, car si on peut directement expliquer au consommateur ce qu’on fait, on n’a plus besoin d’un label.
C’est juste pour démontrer à un public plus large, qui n’a pas accès à nous et auquel on n’a pas accès qu’on fait bien et qu’on respecte les règles à respecter.
C’est la société qui nous demande de respecter les règles; parce qu’ils ont envie de manger bio, ils respectent ce cahier des charges pour répondre à cette demande. Donc c’est pour toucher un public large qui n’a pas la possibilité de venir voir. Il va falloir passer par un organisme intermédiaire qui garantit qu’ils respectent bien l’engagement.
Comment pourrait-on communiquer autrement sur les produits ?
Suite à l’urbanisation, il n’y a plus de proximité entre consommateur et producteur. Un effort de Nature & Progrès, une rencontre, une démarche (militants, gens qui savent) qualité environnementale (distance parcourue…).
Rencontre avec un producteur de lait, Pierre Robert
Localité : La Rigaudie, 81120 Ronel
Superficie : 77 hectares
Date d’installation : Depuis 5 générations
Label : Biolait

Pierre Robert est un producteur de lait, depuis 5 génération avec sa famille.
Tout le matériel utilisé à la coopérative est acheté à plusieurs (13 personnes), ils se répartissent les tâches, nettoyage du matériel, gérer le planning...
Ils organisent des réunions les samedis, des apéros, discussions, des moments de convivialité afin d’organiser le planning pour la semaine suivante.

L’obtention de la certification, ses rapports avec les organismes certificateurs
Pierre Robert a quitté Sodiaal. En voulant faire la transparence, le directeur de Sodiaal s’est planté complètement pour la répartition d’argent. Les directeurs prennent le pouvoir au profil de directeur financier. Ils ramassent de l’argent, qui normalement devait être redistribué. Dans les réunions Sodiaal, il n y a pas de brassage d’idées, les décisions sont déjà prises, elles sont démocratiques mais pas représentatives. Pierre Robert change alors au Biolait. Ici, c’est les producteurs qui gouvernent. Leurs réunions tournent autours de discussion et compromis.
Quelles méthodes de culture sont mises en place pour pallier au maladies des plantes et pour éviter les intrants chimiques ?
Les vaches sont traitées une fois par jour, puis elles mangent du foin et de la farine, régulées avec la pierre de sel, mélange de grains le soir naissances terminées.
Temps de culture, fréquence des rendements
En moyenne une vache fait 5 à 6 lactations. Leurs âges varient entre 6 à 10 ans. Entre 20 et 25% de renouvellement. Entre 4 et 5 ans tout est renouvelé, elles sont engraissée puis envoyée à l’abattoir à cause de épuisement dû à la lactation. Les veaux naissent sur septembre, octobre, novembre, décembre sur 3 mois ou 4. Ils passent 6 mois à l’intérieur puis ils sortiront l’été prochain. 10 ou 12 femelles sont conservées et les autres sont vendues à d’autres éleveurs, pareillement pour les mâles. Croisement de races de vaches, vaches rustiques qui sont moins sensibles aux maladies et dont une meilleure qualité de lait au niveau de la matière grasse et les protéines.

Rapport au contrôle en tant que producteur ?
Une exploitation de deux hectares qui est entre deux autres exploitations voisines, un petit champ pas large et long.
Cette année cette exploitation est consacrée à la production de céréales. Deux ans de production de céréales et un an en herbe. Mais l’année prochaine cela ne sera pas possible car le champ sera touché par les autres exploitations. l’année prochaine il faudra le mettre en herbe et non en céréales car cela représente un risque. Il y a toujours un voisin en conventionnel, 2 seulement sur la commune sont en bio. Il y a souvent des échanges avec d’autres collègues et discussions sur le sujet.
La position du producteur vis à vis des labels
Les AMAP sont un contact direct avec producteurs qui font du bio mais qui n’ont pas de label ils veulent le faire mais les consommateurs savent et connaissent les manières de travailler du producteur et les consommateurs sont d’accord pour manger.
Comment pourrait-on communiquer autrement sur les produits ?
Si il n’y avait pas la notion de label, une plateforme de partage, virtuelle ou physique ? On saurait tous ce que chacun fait, toutes les informations seraient sur cette plateforme. L’AMAP est un collège, le nouveau producteur qui rentre dans une amap doit prouver qu’il produit d’une certaine manière, il doit démontrer qu’il fait du bio. Donc il y a malgré tout un label caché, celui de l’AMAP (comme garantie) mais comme c’est à petite échelle, il n’y a pas forcément besoin d’une certification, la confiance s’établit sans.
Le problème vient de la distance en le producteur et le consommateur. Comment deviner que quelqu’un fait du bio si c’est pas écrit dessus? Si tu écrit dessus que tu fais du bio et que c’est pas vrai tu fais de la publicité mensongère
Rencontre avec un maraîcher et producteur de fruits, Les vergers de Notre-Dame
Localité : Buzet sur Tarn
Superficie : ± 20 hectares
Date d’installation : 2004
Type de culture : Maraîchage et producteur de fruits (principalement de pommes)
Label : Vergers écoresponsables

Bernard Loïc Calleja a passé 20 ans à Paris avant de reprendre l’exploitation de son père exclusivement centrée sur la production de pomme. Il a développé cette activité en amenant un plan de diversification à trois niveaux : sur les modes de distribution (en passant de la vente en coopérative à des circuits courts ainsi qu’à la vente directe), sur la création d’une production maraîchère et sur la rénovation d’un corps de ferme. Cette rénovation lui a notamment permis de fonder une activité agro-touristique (maison d’hôte et salle de réception).
On retrouve deux types de productions à la ferme : vergers et maraîchage.
Vergers, de juillet à novembre : cerises, abricots, pêches, nectarines, fraises, framboises et petits fruits, coings, pastèques, figues, pommes (plus de 20 variétés), poires, noisettes.
Maraîchage : 25 variétés de tomates, 4 d’aubergines, de poivrons de concombres et de pommes de terre, 3 de courgettes, mais aussi ail, oignon, échalote, salade, blette, haricot vert, poireau, navet, betterave, fenouil, choux, céleri, cucurbitacées.
Au quotidien, Bernard Loïc Calleja s’occupe principalement de l’administration, des livraisons et des distributions. Deux personnes sont employées sur l’exploitation (un contrat permanent et un contrat saisonnier) principalement pour la taille et la préparation des commandes. Cet effectif est complété en fonction de la somme de travail.

L’obtention de la certification, ses rapports avec les organismes certificateurs
La production de Bernard Loïc répond à 80 % aux critères du label bio.
En effet, même s’il envisage de convertir sa production maraîchère dans les années à venir, une partie de ses plans ou graines ne sont, actuellement, pas encore agréés en agriculture bio. Sur le plan des engrais, il a recours aujourd’hui aux produits chimiques et souhaiterait rapidement utiliser des engrais naturels. Les pommes, cependant, sont agréées par le label Vergers Écoresponsables.
Quelles méthodes de culture sont mises en place pour pallier au maladies des plantes et pour éviter les intrants chimiques ?
En premier lieu, Bernard Loïc traite les plants contre les champignons dès que la feuille commence à sortir. Dans le but de minimiser l’impact des fongicides chimiques sur les sols il a recourt à des techniques comme le broyage de feuilles à l’aide d’une machine qui permet d’atténuer la venue des champignons.
Les deux principaux nuisibles de la pomme sont le Carpocapse (papillon du vers de la pomme) et l’araignée rouge (acarien). Ici aussi, Bernard Loïc favorise une observation approfondie des parasites pour pallier à l’utilisation de traitement chimique.
• Diffusion de phéromones contre le carpocapse durant des périodes précises, si nécessité.
• Inspection de la présence du prédateur de l’araignée rouge.

Temps de culture, fréquence des rendements ?
La récolte des pommes à lieu de fin août (ou début septembre) à janvier (ou début février). Une pomme poursuit son évolution une fois récoltée. Pour pallier à cette dégradation naturelle Bernard Loïc a mis au point un système de mini chambres froides. La conservation des pommes se fait donc grâce à un système de modules qui peuvent contenir jusqu’à 300kg de pommes chacune. Ce dispositif s’apparente à des chambres froides de taille réduite et permet d’étendre la période de vente jusqu’en mai ou juin. La réduction de la taille des chambres permet d’écouler de plus petits stocks de pommes. En effet, dans un système classique, une fois la chambre ouverte toute la production est atteinte par l’air ambiant et doit être écoulée au plus vite.

Mode de distribution
Deux modes sont appliqués : la vente directe aux particuliers (sur l’exploitation) et une vente en circuit court. Cette dernière, exclusivement basée sur la vente internet et les livraisons, existe grâce à l’intermédiaire de la plateforme La Ruche qui dit oui ! avec six à sept points de vente. Dans ce cadre, et comme précisé plus haut, Bernard Loïc prend en charge la préparation des commandes, la livraison et la distribution.
Rétribution financière
Le rendement varie en fonction du produit tant au niveau de son adaptation aux sols, au climats, etc. que de son succès auprès des clients. Comme précisé plus haut, La Ruche qui dit oui ! est actuellement la principale plateforme de vente pour les produits de Bernard Loïc avec la location de chambres et de salles. Également, pour compléter ces revenus, il vend des terres agricoles inexploitées.

La position du producteur vis à vis des labels
Maraîchage :
Selon Bernard Loïc, s’il se convertit au label Bio, ses légumes seront certainement vendus un peu plus cher que dans sa situation actuelle.
Verger :
Bernard Loïc se considère comme un agriculteur raisonné, cependant, selon lui, ce terme reste compliqué à manier. En effet, à l’origine créé par les arboriculteurs, il est aujourd’hui devenu un label repris et contrôlé par l’état ; sa certification devient payante et difficile à obtenir.
Pour pallier à ce contrôle de l’état, les arboriculteurs ont créé leur propre label avec un cahier des charges similaire : le label « Vergers Ecoresponsables ». Ce label, fois d’un respect de la nature et de l’humain, concerne aussi bien l’inspection des produits phytosanitaires que la valorisation du travail humain.

Comment pourrait-on communiquer autrement sur les produits ?
Selon Bernard Loïc, la personne la mieux placée pour parler d’une exploitation reste l’agriculteur. Il est ainsi plus authentique d’entendre un producteur relater sa manière de travailler, son quotidien sur l’exploitation, et la qualité de ses produits qu’il maîtrise parfaitement. Cela permet également un rapport de proximité avec le consommateur dans une complète transparence.
Cependant il regrette que ce mode de communication soit actuellement impossible. En effet, les systèmes mis en place par La Ruche qui dit oui ! (documents transmis par l’agriculteur et gérés par le responsable de la plateforme) ne sont adaptés ni à son désir de communication ni à son emploi du temps.
Propositions esquissées après les rencontres
par Marine D’Agostinis
Cultures