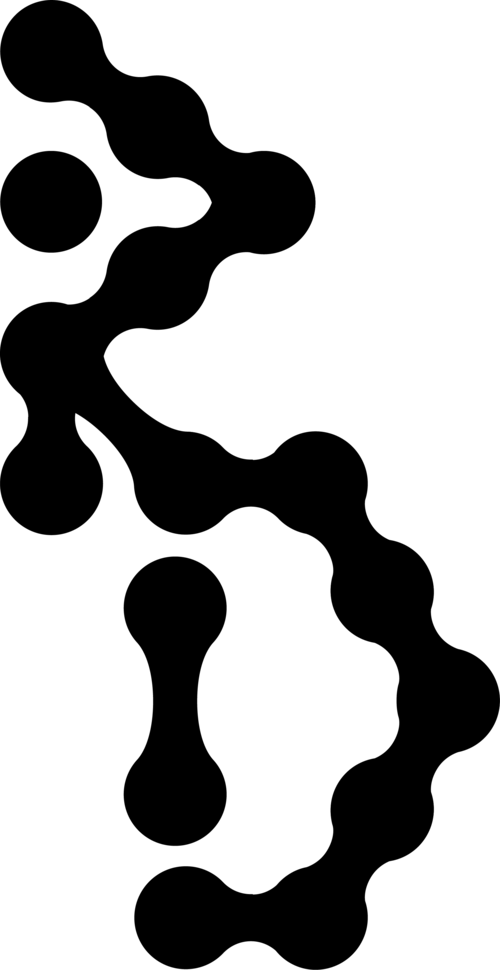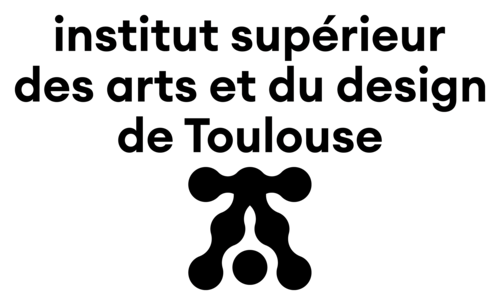Travailler pour nous à Caylus
Travailler pour nous à Caylus est un atelier inscrit entre théorie et pratique, le thème du travail étant l’axe de recherche choisi pour 2016-2017 en design à l’institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT). À partir de réflexions sur la différence entre le travail et l’emploi, le cycle « Travailler pour nous » met l’accent sur les pratiques laborieuses développées en marge du monde professionnel et qui, si elles ne génèrent pas de profit immédiat, n’en demeurent pas moins d’importantes sources de richesse et de créativité.
Un projet sous la responsabilité de Nathalie Bruyère (designer), Jean-Marc Evezard (infographie 2d et 3d) et Laetitia Giorgino (théorie).
Note d'intention de l'atelier :
« Travailler pour nous » vs « travailler pour l’usager »
Par Laetitia Giorgino
L’organisation du régime productif soumis à toujours plus de rentabilité a considérablement affecté le champ des activités humaines (dont le travail fait
partie). Avant la révolution industrielle, celui qui travaille, c’est celui qui est en rapport direct avec les instruments, qui se tourmente par les choses qu’il fait (parmi les différentes origines du mot travail, on retrouve cette signification liée au tourment). Aujourd’hui, le travail s’est transformé, il est devenu l’affaire d’un marché généralisé et perd la plus grande partie de ses attributs (1)
Signe de cette transformation, le fait qu’à notre époque, « le temps de la fabrique compte moins que le temps de la distribution, du commerce, de la consommation ». Progressivement le travail disparaît pour laisser place à l’emploi, lequel se caractérise par « le productif prédéfini, à l’initiative absente, à la marge de manœuvre réduite ». L’emploi est planifié, dirigé, contrôlé par un agent professionnel. « Nous ne sommes pas dans le même état si nous sommes employés au profit d’une logique systématique et si nous travaillons avec nos modes de production avec les techniques en cours. » (2) Malgré tout, des efforts productifs subsistent sous la forme d’un labeur non rémunéré, qu’un auteur comme Ivan Illich nomme le chômage créateur, en prenant notamment l’exemple de la construction de son habitat. Tout en avançant néanmoins que « la faculté d’être utile à soi-même et aux autres ailleurs que dans son métier ou son poste a été efficacement paralysée. Tout labeur non rémunéré est méprisé, sinon ignoré. » (3) La société industrielle telle qu’elle s’est organisée tend à fournir en surabondance des biens et des services, cette surproduction laissant peu de place aux initiatives humaines. Dans un tel contexte, rares sont les échanges productifs échappant au commerce marchand. Pour Illich, l’augmentation de la production s’accompagne de la diminution de cette capacité innée qu’ont les hommes de faire ce qu’ils peuvent pour eux-mêmes et pour les autres. L’homme est ainsi tendanciellement mis à l’écart des opérations productives. Cela se manifeste par exemple dans le fait qu’il n’est pas en situation de pouvoir comprendre les outils avec lesquels il travaille, ce qui le place dans une relation de servitude vis-à-vis de ces outils. Les outils et les techniques sur lesquels ils reposent ne sont pas ici à mettre en cause en tant que tels, c’est bien le régime de productivité intensive astreignant l’homme qui pose question. La formulation « travailler pour nous » est une alternative à une autre formulation très répandue dans le champ du design qui consiste à dire pour certains designers qu’ils travaillent pour l’usager. Cette façon de dire et de parler de l’orientation de la tâche du designer pose différents problèmes. D’abord parce qu’elle réduit tout un pan de la population à l’état d’usager, c’est-à-dire de personne qui ferait d’un objet, d’un outil, d’un service un usage conformément à ce qui aurait été anticipé, par avance (par devers lui), par un concepteur. Cette formulation sous-entend une séparation entre d’un côté un designer-concepteur qui se charge de penser pour ou à la place des gens et de l’autre côté un usager qui a recourt à un outil, un service, un espace que l’on aurait pensé à sa place. Remplacer le terme « usager » par « nous » renvoie à une entité plus vaste et permet de réunir celui qui pense, conçoit, dessine, fabrique et celui qui se trouvait jusqu’alors habituellement désigné par le vocable (terme) « usager ». Cette formule alternative unit au lieu de diviser, celui qui conçoit, dessine, fabrique est susceptible d’être à son tour celui qui fait avec ce qui a été conçu, dessiné, fabriqué. Ce faisant il peut être amené à ouvrir l’outil, l’espace ou le service à de l’imprévu, à lui découvrir de nouvelles fonctions par exemple.
Notes
On se référera pour comprendre ces mécanismes à la conférence de Mireille Bruyère, intitulée « Vers une société de travailleur sans travail » prononcé à l’isdaT en 2016 à l’occasion de la journée d’études « Précarité et habitat ». Dans cette conférence, elle met en relation les mutations du travail avec la transformation du capital sous la forme liquide.
Pierre-Damien Huyghe: « Travailler pour nous » in À quoi tient le design, Grenoble, Éd. de l’Incidence, 2014, p.61
Ivan Illich: « Le chômage créateur » in Œuvres II, p.76 (1977)
Le compte-rendu de l'atelier